Dans le cadre spécifique de la recherche universitaire, la langue n’est pas un « moyen de communication » dont on peut économiser les signes en les « ré-encodant », selon les besoins d’un groupe particulier,mais constitue un lieu et un outil de réflexion dont la logique qui le structure interfère directement dans son utilisation dans toute recherche. D’autres mieux outillés que moi, pour aborder cette question, sauront en dire plus et certainement l’expliquer, mais pour ma part, pour avoir encadré durant des années, des recherches en Mastère et en Doctorat, dans les disciplines proches des Sciences et Théories des Arts et du Design, j’ai pu constater que la maîtrise de l’Arabe ou du Français, par un doctorant, constitue un des atouts majeurs de sa réussite dans la conduite de sa recherche.
Il ne s’agit pas, non plus, de la connaissance que l’on dit nécessaire, de sa langue d’origine, pour l’étude de la pensée d’un philosophe ou bien d’un théoricien de l’art, ou même d’un artiste ; ni de l’apprentissage, obligé, d’une langue telle que l’Anglais, pour accéder à des données bibliographiques, supposées plus actuelles.
Pour des domaines de recherche touchant aux sciences humaines tels que l’Esthétique, la Théorie des Arts de l’Espace et du Temps, les mots ont autant d’importance que les choses. Pour relater et faire voir la réalité, réputée ineffable, du produit de l’acte créateur, il est nécessaire d’opérer un travail de transformation sur les mots. Et comme le signale le précepte bouddhiste, « les mots, à eux seuls ne peuvent rien dire. Les choses à elles seules, ne peuvent rien dire non plus. Il faut couvrir les choses avec les mots et procéder au ponçage de ces mots, afin que l’on puisse voir les choses à travers les mots rendus transparents ».
Il s’agit, comme on peut le constater, de couvrir, pour « dé-couvrir » ensuite. Car la réalité ne nous est accessible que médiatisée par la langue, qui est de nature opaque et qu’il faut rendre transparente par l’activité d’interprétation qui mène à la découverte, à laquelle aspire toute activité de recherche.
Dans ce cas, ce n’est pas seulement la réalité examinée qui est l’objet d’interprétation par le chercheur, mais également la langue elle-même dont on se sert, comme lieu et matière d’expression. L’on peut alors deviner qu’une recherche de qualité qui assure l’originalité de son produit nécessite un niveau élevé de maîtrise de la langue ; car tout le travail sera effectué dans la nuance, s’agissant d’une pensée complexe qui ne peut négliger le moindre détail, dans les plis duquel « le diable pourrait se cacher ».
En prenant en considération, l’importance que l’on pourrait accorder à la maîtrise de l’Arabe ou bien du Français dans l’effectuation d’une recherche universitaire et quel que soit le champ dans lequel celle-ci pourrait s’inscrire, il pourrait s’avérer nécessaire, dans le contexte d’une démarche qualité, de procéder à la programmation de l’enseignement de ces langues de recherche, comme matières transversales, aux côtés de l’Anglais et de l’Informatique. Ce qui ne va pas sans l’obligation, pour ceux qui vont avoir la charge de ces enseignements, de moduler le contenu de leurs cours, en fonction du champ de savoir et de recherche dans lequel ces cours vont s’inscrire.
L’on pourrait, par la même, dépasser, ainsi, dans et par la pratique, les faux problèmes, sur fond de « crise identitaire » qui nous ont conduits à confiner l’usage de l’Arabe dans les limites d’une conception métaphysique, d’une Authenticité pérenne, dont la fonction est de servir d’antidote à une Ouverture, estimée nécessaire, mais vécue sur un fond de culpabilité, qui nous fait « rentrer dans l’histoire à reculons ».
Cette attitude « réactionnelle » de préservation de notre langue-support d’identité peut être à l’origine d’erreurs qui peuvent affecter, qualitativement, la recherche scientifique, effectuée dans le champ des sciences humaines, dont l’histoire et la sociologie de l’art.[1]
Ce rapport métaphysique, idolâtre, à la langue du Coran, se retrouve, en fait, à l’origine de tous les formalismes que l’on peut observer à l’œuvre, chaque fois que des chercheurs font usage de l’Arabe, non par nécessité méthodologique, dictée par la nature même du corpus, objet de leur recherche, mais pour des raisons psychologiques que l’on dit « de principe».
Les occasions les plus remarquables que les intellectuels arabes, ont eues, pour faire usage « de principe » de leur langue, durant les cinquante dernières années, se situent au moment où certains pays d’Orient, sous l’emprise des idéologies de l’ « Arabisme », avaient décidé d’« arabiser » le vocabulaire propre aux différents savoirs actuels, élaboré, à l’origine, dans les champs d’expression, des langues des nations, dites technologiquement, avancées.
Dans la plupart des cas, cette activité de traduction, n’était pas motivée par une meilleure connaissance du contenu réel de ce vocabulaire, auquel on avait accès directement dans ses langues d’origine, mais par le besoin de principe de nous prouver à nous-mêmes et de démontrer, à l’Autre, que notre Langue nationale est capable de contenir le savoir technique et scientifique de notre temps. C’est une question de principe ! Comme pour les discours des chefs d’Etat, quand ils se déplacent à l’étranger. Et si, dans ces cas, très particuliers, de dialogue entre partenaires politiques, l’emploi, de principe, de sa langue est symbole de souveraineté et relève de l’affirmation de sa différence, il en va tout autrement de la volonté d’arabisation de principe du savoir contemporain.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’on avait souvent désigné cette activité de « traduction » sous le vocable peu technique d’ « arabisation ». Cela avait commencé par des lexiques et glossaires des termes techniques désignant des outils, des instruments, des machines et des activités de manipulation ayant rapport avec la mécanique et le champ des sciences et techniques contemporaines, en général. Les mots, renvoyant, seulement, à la réalité univoque d’objets dont le sens se limite à leur fonction et à des activités dont les moyens sont en adéquation absolue avec leurs fins, ne peuvent prétendre à aucune dimension interprétative de cette réalité de nature instrumentale. La réalité métaphysique de cette « technique », s’accommode bien de mots coquilles vides, parce que délestés de leur densité d’expression, considérés, dans ces cas, comme simple enveloppe qui ne fait que mouler l’objet dans des vocables qui n’ont d’arabe que le son. Le vocabulaire technique, étant expression d’absolu, peut se laisser mouler dans toutes les langues, indifféremment.
Reste à signaler que les techniques de moulage linguistiques propres à chaque langue, tout en pouvant devenir l’objet de consultations entre experts, académiciens, n’interfèrent pas, pour autant, sur le sens inamovible d’un objet instrument.
Tout cela pour dire que si cette arabisation du vocabulaire technique n’avait pas eu d’incidence déformante, sur la vision que les usagers de la langue arabe auraient du monde de la technique, c’est parce que ce monde constitue, en lui-même, l’expression la plus achevée de l’Absolu qui peut se passer de toute expression de langage humain, relative par essence, et que cette expression, incarnée par la technique, est, en dernière analyse, d’essence divine. Nietzsche n’avait-il pas écrit que « ce que l’on donnait autrefois à l’Eglise, on le donne aujourd’hui, avec bien plus de parcimonie, à la Science.[2]
Cette arabisation du savoir actuel n’avait pas eu d’incidences négatives, tant que cela se limitait aux lexiques et glossaires des termes techniques. Ce ne sera plus le cas, le jour où l’appétit idéologique de la volonté d’arabisation s’était attaqué à un champ de savoir humain, particulièrement chargé d’activité symbolisante, à caractère visionnaire et même existentiel. Il s’agit de l’histoire de l’Art occidental, avec ses Noms propres d’Artistes et d’Ecoles, ainsi que ses moyens techniques d’expression, toutes en rapport avec les différentes visions du monde qui marquent, de leurs ruptures, l’évolution particulière de la Philosophie du Sujet.
J’avais à peine trente ans, lorsque j’avais entamé la rédaction d’un mémoire de « maîtrise de spécialisation » sous la direction du Professeur Jullian dont le bureau était situé à la salle des plâtres de l’Institut d’Art et d’Archéologie de la Rue Michelet, à Paris. Le sujet était consacré à « la critique d’Art d’expression arabe et l’Art contemporain » et la recherche, au départ, devait m’obliger à rassembler un corpus significatif, suffisamment représentatif de la production en la matière, de l’ensemble du Monde arabe. J’avais donc pensé m’adresser à l’Unesco, pour m’aider à organiser une rencontre entre plasticiens et critiques d’art arabes qui m’aurait fait l’économie d’un périple coûteux et d’organisation difficile. J’avais pu obtenir une entrevue avec le Président de l’AIAP [3] dont le bureau était situé dans les bâtiments de l’Organisation Internationale de la Place de Fontenoy. Quelques temps après, j’ai été informé, par écrit que ma proposition a été acceptée et je rentrais en Tunisie, pour participer à la « Première rencontre des plasticiens et critiques d’art arabes », organisée par l’Unesco, au Centre Culturel International de Hammamet, dirigé, à l’époque, par Tahar Guiga. J’y devais faire la connaissance, particulièrement, des algériens Mohamed Khadda et Béchir Yelles ainsi que des marocains Férid Belkahia, Mohamed M’lihi et Abdallah Stouky.
Le programme prévoyant une séance de discussions après chaque communication, un débat avait suivi l’exposé d’étudiant que j’avais fait autour de la notion de « Peinture de chevalet » et à ma grande surprise l’un des participants d’un pays du Golfe m’avait interpelé en me disant qu’il ne voyait pas l’intérêt à soulever pareil débat, d’autant plus que lui-même, pour peindre « n’utilisait pas du tout de chevalet ». Cela, il l’avait dit en Arabe, tout comme moi qui avais utilisé, dans mon exposé, la traduction donnée par un professeur syrien, Afif Bahnassi, qui, interprétant à la lettre le sens des mots, avait transformé « Peinture de chevalet » en « peinture adossée à un support » ; traductionqui figurait dans un glossaire des expressions propres au champ des Arts Plastiques et de l’histoire de l’Art qu’il venait d’éditer, dans le cadre d’une campagne d’arabisation, menée par la Syrie. Le glossaire en question contenait, également, des traductions de noms d’Ecoles de peinture qui faisaient subir à ces « Noms propres de tendances artistiques particulières, la même réduction qui transformait l’Impressionnisme en « peinture d’impressions » الإنطباعية, le Fauvisme en « peinture à la manière des fauves » الوحشيةet le Cubisme en « Cubisation » التكعيب. L’on peut comprendre la gravité des contresens que peuvent introduire ces traductions d’appellations qui renvoient, en réalité, àdes significations, historiquement conjoncturelles, adoptées en Noms Propres ou bien en signe de ralliement pour un groupe d’artistes et non pas à une quelconque recette de peinture. Ceux, parmi les usagers de la langue arabe qui n’auraient pas accès à la possibilité de comprendre, dans leur contexte culturel d’origine, les significations particulières de ces appellations, risquent fort de n’avoir de choix que celui qui consiste à subir cette induction en erreur programmée, au nom d’une arabisation, forcée, de la culture de l’Autre, réalisée à des fins purement idéologiques.
Je voudrais faire remarquer, pour clore cette évocation de l’activité de traduction, en langue arabe, du savoir contemporain que, paradoxalement, les Anciens qui n’avaient pu s’empêcher d’arabiser et même d’islamiser la pensée grecque, en procédant à sa traduction active, (interprétation), n’avaient pas, comme les Modernes, l’intention, hautement déclarée, d’ « arabiser » cette pensée. Le fait que l’élite de l’époque n’avait pas de rapport d’identification subjective à une langue de civilisation et de pouvoir qu’était l’Arabe, pour ses membres non arabes et parfois non musulmans, n’est peut-être pas étranger à cette distanciation qui avait prémuni ces derniers de la tentation idéologique de transformer leur activité de traduction, en arabisation.
Cette réflexion, nécessairement approximative, parce que individuelle, ne peut être qu’une tentative de recherche d’indices, sur la base desquels, pourraient s’effectuer un véritable travail d’investigation, destiné à actualiser l’horizon des contenus et des méthodes d’enseignement des disciplines, en rapport avec les langues, les lettres, les arts et les sciences sociales. Et ce, en vue de donner à nos étudiants, les profils adéquats qui les rendraient producteurs et participants actifs à une économie moderne dont on dit qu’une bonne partie est, aujourd’hui, constituée par l’industrie culturelle.
——————————————————————————————————–
[1] Ce qui m’amène à évoquer, ici, les cas de plusieurs recherches, en Sciences de l’Art dont j’ai fait partie de leurs jurys de soutenance et dans lesquelles les doctorants, traitant de sujets en rapport à l’histoire de l’art occidental, le font dans un style arabe archaïsant. Le recours à ces effets de rhétorique, de forme et de vocabulaire empruntés à un mode de penser et de sentir pour le moins étranger à l’esprit de recherche scientifique qui, en principe doit être celui de la recherche universitaire, fait qu’on l’on ne peut considérer cela que comme un moyen de se draper du manteau de l’authenticité, pour faire passer pour scientifiquement « légitime », le contenu d’un discours qui ne fait que reconduire, en les transposant, des idées générales sur l’histoire de l’art occidental. La juxtaposition de « l’authenticité »de l’expression à la superficialité du contenu, signifie qu’il s’agit, en fait, d’une « panacée contradictoire » à partir de laquelle le chercheur formalise son rapport à la langue arabe, tout en se privant de passer les notions et concepts importés du champ de pensée occidentale, au crible de la critique, par le recours à la nécessaire distanciation.
[2] Nietzsche : Considérations inactuelles T.1.page 212. Traduction Henri Albert, Mercure de France, Paris. 1907
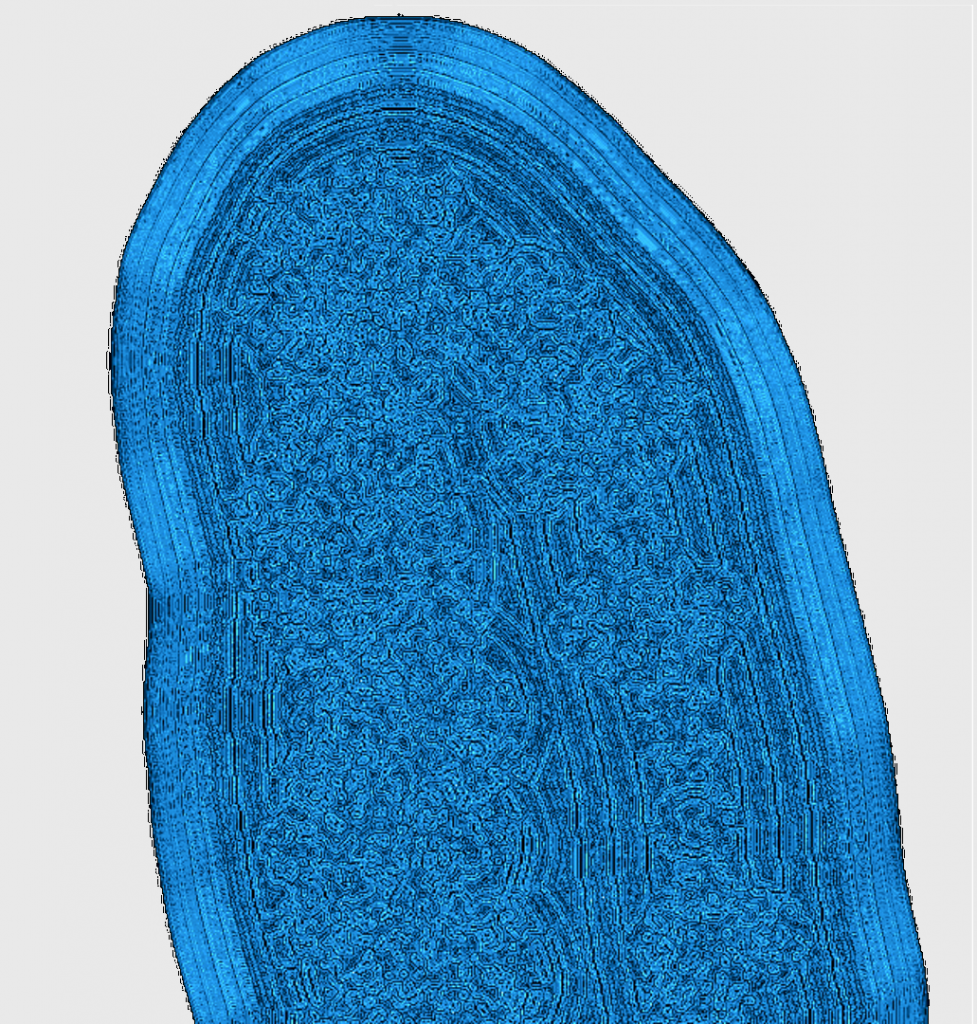
Répondre